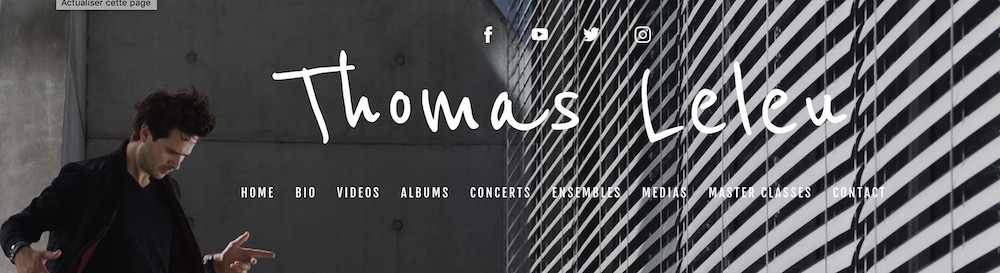Avant 2012 et la victoire de la musique remportée par le jeune prodige Thomas Leleu, le tuba, c’était surtout une affaire de… Tubistes. Au mieux, l’imposant cuivre évoquait dans nos imaginaires des réminiscences de fins de soirées festives sur les places de nos villages au son de fanfares pas forcément très justes. Mais ça, c’était avant ! Avant que le petit Mozart de l’instrument à la gueule d’ange, Thomas Leleu, ne dépoussière l’image du gros cuivre, l’extirpant de son carcan populaire pour l’inviter à faire peau neuve tout autant dans les orchestres de musique classique que sur les rythmes chaloupés venus d’Amérique latine. Aujourd’hui, avec « Born to Groove » (NoMadMusic), le tuba de Thomas Leleu poursuit son grand écart facial entre Brésil, Arménie, influences électro et inspirations schubertiennes. Alors, Tuba or not Tuba ? On ne se pose même plus the question !
« Cette tendance à coller des étiquettes aux gens est restrictive et s’avère un frein à la liberté de créer. »
Avant votre victoire de la musique de 2012 qui a permis de mettre en lumière votre instrument et vos inspirations musicales, le tuba, c’était souvent entre tubistes ! Au-delà de votre succès personnel, était-il important de sortir le tuba du carcan dans lequel il était enfermé ?
Cela a toujours été l’une de mes envies dans le sens où je n’ai jamais souhaité faire ce qui justement avait déjà été fait. Le milieu du tuba est celui dans lequel j’ai grandi, évolué et ai été éduqué puisque mon père est tubiste. Je trouvais intéressant d’avoir une ouverture d’esprit et de proposer une autre facette de l’instrument auprès d’un nouveau public qui ne s’attendait pas forcément à entendre le tuba sur de nouveaux registres sonores. Même si j’ai été le premier à remporter une victoire de la musique avec cet instrument, je ne suis pas le premier à avoir ouvert son champ des possibles puisque Marc Steckar, merveilleux multi-instrumentiste, avait déjà poussé le tuba dans le registre du jazz et des musiques afro-cubaines. Marc Steckar a été pour moi une vraie source d’inspiration et m’a donné le désir de pousser les choses encore plus loin, sortant ainsi de cet univers purement « tubistique. »
Un tuba, ça peut être un son polyphonique, des slaps en tapant l’embouchure avec la langue ou la possibilité de produire un son proche de celui du didgeridoo, est-ce côté protéiforme du son du tuba qui, en plus de la filiation paternelle, vous a attiré vers cet instrument ?
Au départ, j’ignorais qu’il était possible de réaliser tous ces effets avec un tuba. Avec mon père qui jouait dans l’orchestre de l’opéra de Lille, je connaissais la sonorité veloutée, chaleureuse du tuba et c’est ce qui m’a d’abord attiré vers l’instrument. Après, j’ai effectivement découvert tous ces effets avec François Thuillier, qui a été l’un de mes professeurs. Si, au début, ce sont ces sons de grave du tuba qui m’ont immédiatement attiré, aujourd’hui je ne joue quasiment plus dans ce registre-là puisqu’étant soliste ou leader de mes projets, je dois me situer principalement dans une tessiture médium/aigue afin que le tuba puisse passer devant les autres instruments.

On a souvent, par le biais des fanfares, une image très populaire du tuba. Etait-il important de quelque peu anoblir l’instrument et montrer qu’il s’intégrait musicalement quels que soient les genres ?
Le tuba a été inventé dans les années 1830, au départ pour la fanfare avec vraiment ce rôle de basse. J’ai moi-même débuté dans une fanfare et ne renie donc pas ce passé, cet héritage qui fait partie intégrante de l’histoire du tuba. J’avais néanmoins vraiment cette envie de l’intégrer à d’autres styles musicaux et le sortir de son rôle qui se limitait à la fanfare pour l’inviter à se confronter à des registres qui sortaient de ce moule ou de la musique classique.
Vous dîtes d’ailleurs qu’en fonction des pays le regard n’est pas le même. Là où, en France, on vous demande si vous transportez un djembé, en Allemagne on vous questionne quant à savoir si vous avez déjà joué Berlioz ou Wagner. La France manque-t-elle selon vous de « culture » classique ?
Je ne sais pas si la France manque d’une certaine culture classique mais je pense surtout que le classique pourrait être mieux considéré par certains. Je vis à Berlin depuis quatre ans et, au-delà de la musique, c’est de culture au sens large dont on parle. Je ne dis pas que l’Allemagne est le meilleur pays du monde, mais je pense que musicalement, ces concitoyens sont certainement plus « éduqués » au classique et ça dès le plus jeune âge. Moi, à l’école, on ne m’a jamais parlé des compositeurs français, de Rameau, Ravel ou Debussy et je trouve cela dommage. Je n’ai eu accès à cette connaissance culturelle qu’au conservatoire. Il est certain que le tuba n’est pas reconnu de la même façon dans tous les pays et, même si je n’ai pas la prétention de changer les choses, il est assez appréciable, en Allemagne notamment, de ne pas se sentir enfermé dans une case bien précise comme cela peut être le cas en France. Cette tendance à coller des étiquettes aux gens est restrictive et s’avère un frein à la liberté de créer. Avec ce nouvel album, « Born To Groove », j’ai souhaité m’affranchir d’une quelconque étiquette et mettre en lumière mes racines classiques dans une collaboration avec des musiciens de jazz pour créer un entre-deux, en espace qui, justement, s’avère propice à la création. En France, on a tendance à être encore très attachés aux traditions musicales là où, en Allemagne, c’est beaucoup plus ouvert. Il m’arrive par exemple de jouer dans des festivals qui n’ont jamais reçu un tuba en soliste et pourtant, la salle est pleine. En France, j’ai remporté une victoire de la musique pour parvenir à convaincre certaines personnes de l’étendue du registre sonore du tuba, et encore, il me reste pas mal de travail à accomplir pour réussir à convaincre tout le monde.

Même si vous venez du classique, vous aimez ce crossover, le fait de passer d’un genre à un autre, d’opérer des ponts entre les styles. On sait que même si ces ponts sont aujourd’hui plus nombreux (Gilles Apap, Jean-Marc Phillips-Varjabédian, Baptiste Trotignon…), la musique classique pâtit surtout auprès de la jeune génération de son côté figé. Sortir des sentiers battus, passer d’un monde musical à un autre, est-ce tout autant le prolongement de vos propres goûts que ce souhait de quelque peu participer à dépoussiérer cette image de la musique classique ?
Je n’ai pas tenté de trouver des ponts entre les musiques pour aller chercher un éventuel « nouveau » public. Je l’ai fait parce que j’en avais profondément besoin, envie et que cela correspond à ma personnalité dans le sens où, lorsque je répète trop souvent la même chose, je finis par m’ennuyer. J’ai besoin d’un renouvellement permanent. J’avais ce désir de passer du registre d’interprète à celui de créateur, proposant ma musique, mes sonorités avec ce souhait de créer mon univers artistique. Concernant la musique classique, même si des actions sont menées pour inviter un nouveau public à s’y intéresser et se rendre à l’opéra ou dans les salles, je trouve que le concert symphonique n’a pas vraiment évolué. Aujourd’hui encore, la plupart des orchestres sont dans le schéma : Ouvertures, concertos, symphonies. On sent tout à la fois cette envie d’ouverture, mais une ouverture rendue compliquée par le poids d’une tradition trop pesante avec cette idée sous-jacente que, puisqu’il s’agit de musique classique, il faut rester sérieux ! À mon sens ce genre musical n’est pourtant pas antinomique avec le fait d’être décomplexé et libre. La musique classique reste pour moi essentielle mais il serait peut-être temps de faire un peu évoluer les choses. Le premier single de mon album, « La schubertiade » est d’ailleurs un moyen de créer un pont entre ce monde du classique et les musiques populaires pour, pourquoi pas, amener certaines personnes à découvrir Schubert.
Des musiques d’Amérique Latine, au classique, du jazz à la chanson, des musiques traditionnelles ethniques, aux expérimentations contemporaines, envisagez-vous la musique tel un formidable métissage ?
J’ai toujours pensé qu’il n’existait pas de frontières en musique. Les seules frontières ce sont les musiciens qui les érigent ou bien encore le « système » qui nous dit : « Toi tu es musicien classique et toi tu es musicien de jazz ! » Mettre ainsi les gens dans des cases entrave la liberté et génère des aprioris qui collent à la peau. Je suis musicien classique, c’est ma culture, mon enseignement, mais, par contre, je prends un plaisir énorme à jouer du jazz. Lorsque je suis avec mes musiciens on ne parle d’ailleurs pas de genres mais de musique au sens le plus large du terme. D’ailleurs, la seule chose qui nous lie, c’est la musique, quelle qu’elle soit.
Un peu comme pour le violoncelle, il y a un côté très sensuel avec le tuba que l’on enlace tel un corps. Quel rapport entretenez-vous avec l’instrument et cette relation a-t-elle évolué avec le temps ?
Cette relation n’a pas vraiment évolué et j’ai toujours le même plaisir à prendre mon tuba dans mes bras. Lorsque je l’ai sur les genoux et que j’en joue, j’ai vraiment cette sensation de le serrer fort contre moi. Quelque part, il me rassure. Monter sur scène sans mon tuba, c’est ne pas savoir quoi faire de mes mains. Je me sens perdu, presque à nu. Il y a effectivement un côté très charnel avec le tuba, comme avec le violoncelle comme vous le mentionniez. Mon tuba, c’est mon compagnon de route, celui qui m’a fait parcourir des dizaines de milliers de kilomètres à travers la planète et, finalement, je ne sais pas si je ne le dois pas plus à lui qu’à moi-même.

Au-delà du cet aspect sensuel, la tuba est un instrument de dix kilos. La relation tourne t-elle parfois au rapport de force surtout lorsque sur scène, vous devez le porter pendant plus d’une heure trente ?
Il y a bien sûr un petit peu de ça, car tenir à bout de bras le tuba pendant une heure et demie sur scène quand, comme moi, on joue sans sangle, c’est effectivement un effort physique. Il y a là une forme de lutte inhérente au fait que le tuba est lourd, qu’il est encombrant… Il y a, avec cet instrument, un côté sensuel et gauche à la fois. On le serre fort contre soi et, en même temps, il est si imposant que, parfois, on se sent dans une forme de difficulté pour se mouvoir comme on le souhaiterait.
Après un an d’une situation pour le moins critique pour le monde de la musique, sans concert et avec des perspectives très floues, vous sortez votre nouvel album : « Born To Groove ». Comment avez-vous vécu cette année loin de la scène qui vous a d’ailleurs obligé à repousser la sortie de cet album, sortie qui doit, je suppose, sonner comme une libération ?!
Évidemment, il a été très compliqué de ne pas être sur scène. Cette année sans concert m’a permis de comprendre à quel point j’aimais ce contact avec les gens. Je monte sur scène pour la musique mais aussi pour ce rapport intime avec le public que seul le concert peut générer. J’adore regarder les gens dans une salle, essayer de capter leur regard, leur sourire… C’est un élément qui m’a profondément manqué. Après, je pense avoir réussi à passer à travers cette situation très anxiogène et difficile grâce à cet album. C’est un projet que j’avais en tête depuis des années, que je pensais sortir au départ au mois de février, puis en avril et, finalement, il sort le 21 mai alors que les salles rouvrent le 19. Il sonne donc comme une véritable renaissance qui tombe à pic. Avec ce disque, j’ai voulu donner de la joie de vivre aux gens, les faire voyager, rire, pleurer, les emmener avec moi dans ma musique, dans une fête d’une heure qui, je l’espère, va célébrer un retour à une vie « normale » où la musique va à nouveau pouvoir se faire entendre.
Cet album comme vous le disiez a mûri pendant des années. Est-il votre parfaite autobiographie musicale ?
Je le pense sincèrement. Sur les 18 titres, j’en ai signé 13 ou 14 et chacun d’eux est inspiré d’un voyage, d’une rencontre, d’une période de ma vie. Par exemple « schubertiade », le thème que je me suis permis de réécrire sur la musique de Schubert, a été composé sur le piano de ma mère lorsque j’avais seize ans. Chaque titre de « Born To Groove » évoque un moment de ma vie et, quelque part, ne pas aimer l’album serait ne pas m’aimer !
Le titre de votre album est « né pour groover ». Peut-on intégrer le groove jusque dans le registre de la musique classique ?
Bien sûr. Je me suis déjà posé la question de savoir comment définir le groove. J’en ai pas mal parlé avec des musiciens et on se rend compte que tout le monde a une définition du groove qui lui est propre. Bien sûr, au départ, le groove, c’est plutôt pour du jazz, du funk, à partir du moment où une musique sonne, qu’elle nous donne cette envie de danser, que l’on ressent quelque chose. Mais le groove peut tout aussi bien s’adapter à la musique classique. Lorsque vous allez écouter un orchestre symphonique interpréter une œuvre magistrale du répertoire, que cela sonne merveilleusement et que vous vous prenez cette musique en plein visage, ressentant une vraie émotion, je pense que l’on peut là aussi parler de groove à partir du moment où les choses sont organiques.
« On ne vend pas la musique. On la partage » disait Leonard Bernstein. Est-ce partage que vous avez aujourd’hui envie de vivre avec le public pour ce nouveau disque ?
J’ai hâte de découvrir la réaction des gens car, pour l’instant, cela reste finalement très virtuel. Le clip est sorti, le single aussi mais les seules réactions que je reçois se limitent à celles via les réseaux sociaux. Il est évident que lorsque je serai sur scène avec ce public en face de moi, qui interagira avec ces nouveaux morceaux, le bonheur sera total. C’est pour ce partage là que l’on fait de la musique. J’ai envie de voir les gens danser et me rendre compte de l’émotion que ces nouveaux morceaux génèrent sur leur visage.

Si vous deviez citer trois disques, en dehors des vôtres, pour vous définir en musique. Quels seraient-ils ?
Il y aurait d’abord les Suites de Bach par Pierre Fournier. Ça, c’est la base ! Je me régalais à écouter ce disque lorsque j’étais adolescent. Après, il y a eu la découverte de la salsa avec un groupe qui s’appelle Sierra Maestra et qui a composé la bande-originale du film « Salsa » sorti en 2000. Ça a été une vraie révélation qui a généré en moi l’envie de me pencher sur ce style musical. Et le troisième, je dirais le disque « Viaggio » de Richard Galliano que j’ai écouté énormément et qui m’a fait découvrir son merveilleux « Tango pour Claude » que je conseille à tous.