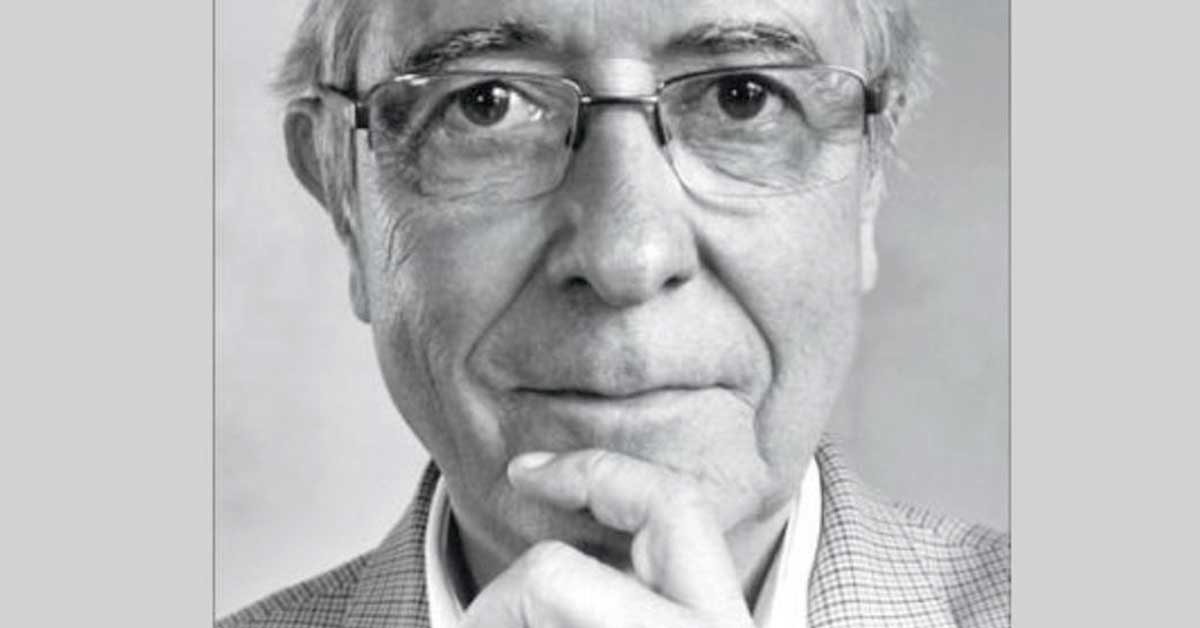Patrick Riou : « Ma vie à la crim’ », éd. Jacob Duvernet
 Patron de la « crim’ », des stups et de la police judiciaire, Patrick Riou a été pendant de nombreuses années l’un des hommes les plus influents de la police hexagonale, un « superflic » comme on les surnomme ! Au mythique 36 Quai des Orfèvres, le commissaire a tout vu, tout connu. Les attentats de la rue de Rennes, le tueur en série Thierry Paulin, la fusillade de la rue de Trudaine… Des événements avec un seul et même point commun : la mort ! La grande faucheuse, c’est le quotidien de tous les policiers, mais lorsque l’on gravite dans les hautes sphères de la crim’, cela devient vite un sacerdoce auquel on ne s’habitue jamais et qui vous poursuit jusque dans votre sphère privée. Pour Agents d’entretiens, Patrick Riou nous fait découvrir l’envers, voir l’enfer du décor !
Patron de la « crim’ », des stups et de la police judiciaire, Patrick Riou a été pendant de nombreuses années l’un des hommes les plus influents de la police hexagonale, un « superflic » comme on les surnomme ! Au mythique 36 Quai des Orfèvres, le commissaire a tout vu, tout connu. Les attentats de la rue de Rennes, le tueur en série Thierry Paulin, la fusillade de la rue de Trudaine… Des événements avec un seul et même point commun : la mort ! La grande faucheuse, c’est le quotidien de tous les policiers, mais lorsque l’on gravite dans les hautes sphères de la crim’, cela devient vite un sacerdoce auquel on ne s’habitue jamais et qui vous poursuit jusque dans votre sphère privée. Pour Agents d’entretiens, Patrick Riou nous fait découvrir l’envers, voir l’enfer du décor !
« Croiser le regard d’un cadavre qui a souffert est une vision qui ne s’oublie pas, jamais ! »
Comment entre-t-on « par hasard » dans la police, comme cela a été votre cas ?
J’ai commencé par des études de droit, un domaine très rigoureux qui me passionnait. J’ai ensuite passé des concours, et celui de la police m’a séduit. À l’époque, j’étais de nature plutôt timide et réservée et je dois avouer qu’à 25 ans, un métier d’autorité avec une belle carte tricolore donne de l’assurance. Nous étions alors en plein mai 1968 et, même si tous les jeunes de mon âge étaient forcément du côté de la révolte, j’ai pris alors une décision paradoxale en choisissant d’entrer dans la police. J’emploie également le terme « par hasard », car les chevaliers blancs qui souhaitent entrer dans la police pour sauver la veuve et l’orphelin me paraissent effrayants. Ils n’ont bien souvent pas assez de recul vis-à-vis des situations auxquelles ils sont confrontés, et ce côté justicier est toujours dangereux. Lorsque je faisais passer des concours, je me méfiais énormément de ce genre de personnes pour qui la police semblait une vocation et qui, par la suite, devenaient souvent des policiers dangereux !
S’habitue-t-on au fait d’être confronté à la mort quotidiennement ?
Toute personne possède un capital soleil ! On s’expose, on s’expose et puis, un jour, on ne peut tout simplement plus encaisser les rayons qui vous brûlent la peau. Face à la mort, je dirais que c’est exactement la même chose. Même si on ne s’habitue jamais au fait de voir un cadavre, on sait parfaitement que cela fait partie du métier. Bien sûr, être réveillé à deux heures du matin et se retrouver une dizaine de minutes plus tard face à un corps qui a été torturé n’est pas facile à gérer, car certaines images envahissent votre esprit pour n’en sortir que très difficilement. Croiser le regard d’un cadavre qui a souffert est une vision qui ne s’oublie pas, jamais ! Et puis, un jour, sans que vous sachiez pourquoi, vous ne pouvez plus tolérer cette vision, cette odeur qui vous prend à la gorge et imprègne vos vêtements. Chaque flic a connu cela, une overdose d’hémoglobine qui sonne comme un signal d’alarme et vous dit que là, il est temps de lever le pied ! Le seul point positif à cela, c’est que lorsque vous avez vu un corps blessé, meurtri, torturé, vous n’avez plus qu’une seule chose en tête : coincer le coupable !
On assiste actuellement à une série de meurtres sanglants et barbares sur lesquels les médias se précipitent. Le crime a-t-il changé ces dix dernières années ?
Contrairement à une idée reçue, les meurtres ne sont pas plus nombreux ou sanglants aujourd’hui qu’ils pouvaient l’être en 1970 ! La différence, c’est que l’on en parle plus. Je déplore d’ailleurs cette mode presque politique qui fait que, pendant que l’on parle d’une affaire sordide, on évite d’évoquer les problèmes sociaux et économiques. Je qualifierais cela d’« effet bombe », un moyen de faire peur aux gens ! Cette façon de faire d’un meurtre violent, barbare, un événement médiatique pour capter l’attention des téléspectateurs et faire de l’audimat m’insupporte. On donne des éléments de l’enquête, on livre le nom du suspect… Tout cela a le don de m’agacer profondément. Il faut savoir qu’aujourd’hui, avec les moyens dont la police dispose, un meurtre est quasiment tout le temps solutionné. Dans votre livre, vous dites que le fait de ne pas avoir de soutien psychologique pour extérioriser les tensions liées à votre métier a été un poids ! À mon époque, il n’y avait pas de psychologue à qui se confier ! Lorsque vous passez une journée éprouvante avec des cadavres, une autopsie, une enquête longue et difficile, vous rentrez chez vous et vous ne pouvez pas vous confier à vos proches. Là, il vous faut faire face aux problèmes quotidiens : la mauvaise note de votre fils, l’autre qui s’est battu à l’école, l’otite du petit dernier… L’accumulation fait qu’à un moment, la cocotte risque d’exploser. Des psychologues sont apparus pour aider les flics, mais je me souviens qu’au départ, personne n’osait y aller ! Il y avait une honte vis-à-vis d’une aide psychologique. Aujourd’hui, heureusement, c’est beaucoup plus rentré dans les mœurs !
Que vous a enseigné la police criminelle ?
Je retiens avant tout la richesse du métier de policier. Je suis passé par les stups, la mondaine, la crim’, la brigade financière, et aucun service ne peut être comparé tant les typologies y sont différentes. Selon les services, vous trouverez des personnes variées, des gens plus courageux, réfléchis… À la crim’, les membres du service sont extraordinaires. Ce sont des policiers qui ont du métier, qui sont parfaitement formés, qui sont républicains… Le seul inconvénient, c’est qu’ils sont conscients de leurs qualités et donc, cela leur donne parfois un tempérament de « danseuse » puisqu’ils se croient les meilleurs. Aujourd’hui, le mythe qui entoure le 36 est, disons, un peu erroné. Il y a une vingtaine d’années, seuls la crim’ et l’antigang pouvaient mobiliser des centaines de policiers en un temps record pour une affaire. Désormais, l’excellence s’est diluée.
Y a-t-il une enquête en particulier que vous gardez comme modèle dans un coin de votre esprit ?
Plus qu’une enquête particulière, ce sont souvent des comportements qui choquent, celui du meurtrier qui n’éprouve aucun remords après son geste. Je me souviens de cette affaire où un homme était entré chez des gens, avait tué la femme et avait traîné l’homme dans le jardin en l’abattant sous les yeux de son fils de neuf ans. Lorsqu’on l’a arrêté et que je l’ai interrogé, le meurtrier m’a ri au nez. À ce moment-là, on se pose vraiment des questions sur la nature humaine ! On se sent totalement déstabilisé et impuissant face à de tels meurtriers de sang froid. Concernant les affaires, je dois avouer être assez fier de celle qui concerne la fusillade de l’avenue Trudaine à Paris, le 31 mai 1983. Deux policiers avaient été tués et nous n’avions aucun élément pour l’enquête. À force de travail, de recoupements de l’information, de planques, nous avons réussi à prouver que cela était l’œuvre des membres d’Action Directe, ce qui a conduit à leur arrestation.
Tout le monde se souvient du face à face Ventura/Serrault dans le sublime Garde à vue de Claude Miller. Comment se passe un interrogatoire à la crim’ ?
Il faut savoir qu’à la crim’, lorsque l’on arrête un suspect, il est déjà cuit ! Soit il nous donne d’autres éléments de preuves, soit il nie et cela n’est vraiment pas à son avantage car on finit toujours par savoir ce que l’on veut. Le film de Claude Miller est assez réaliste dans le sens où il montre bien l’évolution de l’interrogatoire, les différentes phases et la tension qui s’instaure. Souvent, c’est vers 2 ou 3 heures du matin que le suspect craque et se met à avouer. Au milieu de la nuit, il sent que sa vie bascule et, en même temps, il a un poids énorme sur la conscience dont il a besoin de se libérer. Alors, il explique le pourquoi de son geste ! Il faut en effet savoir que seuls les déséquilibrés et les tueurs en série tuent sans motivation particulière, si ce n’est celle de répondre à une pulsion.
Concernant les tueurs en série, je crois que vous avez été sur l’affaire Thierry Paulin !
L’affaire Thierry Paulin a été complexe car nous n’avions aucun élément. Un homme torturait et tuait des vieilles dames pour leur voler leurs maigres économies. Nous n’avions ni témoignages, ni indices… Rien ! Et puis, un jour l’homme laisse une de ses victimes pour morte. Cette dernière, Berthe Finalteri, après un passage à l’hôpital, brosse un portrait-robot très ressemblant de son agresseur. Le portrait est diffusé à tous les commissariats. Quelques jours plus tard, le commissaire Francis Jacob se promène dans la rue avec le portrait-robot sur lui et là, il croise par hasard Thierry Paulin. Il le reconnaît et l’appréhende en pleine rue. Un pur hasard qui a permis de mettre fin à une série de meurtres odieux !
Vous étiez patron de la crim’ lorsque s’est produit l’attentat rue de Rennes en 1986. Quelles images gardez-vous de cet événement dramatique ?
Le hasard a fait que nous n’étions pas très loin de la rue de Rennes lorsque l’attentat s’est produit. Nous sommes donc arrivés rapidement sur les lieux. Les pompiers étaient déjà là et avaient installé trois tentes. Une pour les morts, une pour ceux qui allaient mourir et une pour les personnes gravement blessées qui devaient être soignées d’urgence. C’était le chaos total ! Voir un cadavre n’est pas une chose aisée, mais qu’une personne vous tienne la main en répétant qu’elle ne veut pas mourir et décède là, devant vous, produit un choc difficilement explicable avec des mots. Je me souviens particulièrement d’une jeune femme sur une civière. Les pompiers ont ramassé sa jambe qui se trouvait à quelques mètres d’elle, l’ont déposé sur elle et sont partis avec la civière. L’image était atroce. Là, je me suis mis à trembler de partout, incapable de contenir mon émotion. J’étais tétanisé ! Il m’a fallu au moins dix minutes pour recouvrer mes esprits. Je peux vous assurer que ce sont des journées qui comptent double. Lorsque vous arrivez sur une scène de crime ou une salle d’autopsie, il y a une odeur de mort reconnaissable entre toutes. Une fois que vous avez senti ça, vous reconnaissez cette odeur de très loin. Elle imprègne vos narines comme vos vêtements et, croyez-moi, il est très très difficile de s’en défaire !
Les règlements de compte en plein cœur d’une cité à Sevran, l’assassinat d’un adolescent guetteur à Marseille… Que vous inspire cette nouvelle vague de violence dans les quartiers dits sensibles ?
Auparavant, un tueur était engagé pour tuer un membre d’un clan rival afin de contrôler un territoire. Aujourd’hui, les choses ont changé ! Ce sont des gamins qui, à coups de Kalash, font la loi et s’entretuent afin de « protéger » un territoire. Le problème est que ces jeunes ne voient pas le risque et sont focalisés sur l’argent. Ils n’ont aucune morale et vous tirent une balle dans la tête au moindre problème. Ils sont incontrôlables et, effectivement, la police a bien du mal à endiguer cette vague de règlements de compte entre bandes rivales.
Il existe d’ailleurs des no man’s lands où la police ne se rend qu’en cas de force majeure. Comment expliquer cet abandon du terrain ? Les politiques vous incitent-ils à ne pas envenimer des zones dites sensibles ?
Il y a vingt ans, lors de perquisitions à Sevran ou Montfermeil, on prenait déjà des machines à laver sur la tronche ! Il est cependant vrai que la police d’investigation a été un peu abandonnée. Les problèmes des banlieues, on en parle depuis trente ans et rien n’a été fait ! Les politiques devraient comprendre que ce n’est pas en envoyant trois compagnies de CRS au milieu d’une cité que l’on va résoudre quoi que ce soit. Résultat, aujourd’hui, le terrain est perdu !
On évoque actuellement une dépénalisation des drogues douces. Votre point de vue sur la question ?
J’ai deux enfants et je les ai toujours vu prendre un joint deux à trois fois par semaine. Ils me disent que tout le monde fait ça et je suis certain que c’est vrai. Avoir un père patron de la crim’ ou des stups n’a en rien changé leur comportement. Le gouvernement se dit contre la légalisation, mais comme on ne fait pas respecter les règles, c’est une politique purement démago. Interdire le cannabis au nom de la morale n’empêche pas les gens de fumer !
La police a-t-elle aujourd’hui suffisamment de moyens afin de faire correctement son travail ?
Tout n’est pas qu’une question de moyens, mais il est certain qu’en diminuant ces derniers, vous n’arrangez pas les choses. C’est un peu la même situation que dans les hôpitaux ! Il ne faut pas pour autant augmenter les effectifs sans expliquer quoi faire et donner une politique d’ensemble. Certains ministres le font et d’autres pas. Aujourd’hui, on parle de chiffres auxquels les policiers sont astreints, mais faire du chiffre pour du chiffre, cela n’a aucun sens. Résultat, comme les policiers doivent procéder à un certain nombre d’arrestations pour être bien notés et que toutes les arrestations se valent, ils se contentent d’affaires « faciles ». En suivant de tels raisonnements, les politiques jouent tout simplement avec la sécurité comme avec un petit train électrique.
La cybercriminalité est-elle une menace à laquelle la police est aujourd’hui de plus en plus confrontée ?
Bien sûr ! Les pirates du Net ou les malfaiteurs de la finance vont gagner en un temps record 50 à 100 fois plus qu’un braqueur de banques et cela, en prenant un minimum de risques. Aujourd’hui, plus besoin d’un gros calibre pour être un bandit. Calé confortablement derrière son ordinateur, le truand moderne détourne des fonds, hacke des sites… C’est une nouvelle forme de criminalité à laquelle les policiers vont devoir de plus en plus faire face.
Les hauts postes des fonctionnaires de police ressemblent à des chaises musicales. Regrettez-vous que les attributions de ces postes soient si politiques ?
Autrefois, les postes étaient assez à l’abri des mouvements politiques. Aujourd’hui, si une connerie est faite par un chef, il dégage dans la demi-heure. C’est totalement stupide ! Le bon bord politique n’existe pas dans la police. On est compétent ou pas, et cela devrait rester, à mon sens, le seul précepte valable.