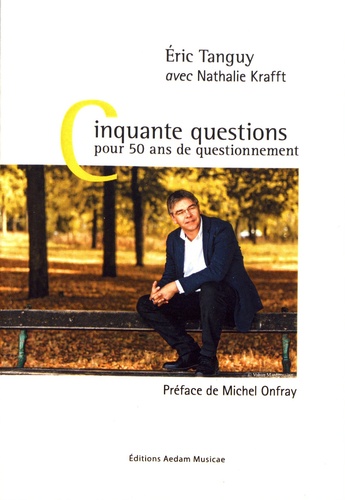Puisque, paraphrasant Nietzche, « toute création est une œuvre autobiographique » comme l’écrit si justement son grand ami le philosophe et essayiste Michel Onfray, de « Vitrail » à « Strange Times », la centaine de compositions qui jalonne le parcours créateur d’Éric Tanguy se veut un manifeste pour le moins exhaustif d’une œuvre née sur les bancs d’une école « buissonnière » revendiquée haut et fort par le principal intéressé. Porté aux nues par ses pairs, le « petit Mozart » de la musique contemporaine a été injustement enterré vivant après son retour de Rome en 1994 par un monde du classique frôlant l’obscurantisme. C’était là visiblement pour Éric Tanguy le prix à payer afin de s’affranchir de tout diktat et gagner une liberté d’expression, vent de liberté qui, aujourd’hui, souffle sur les plus illustres chefs et interprètes internationaux qui rendent grâce à ses œuvres. Et puisqu’il faut bien mourir un jour, autant « mourir vivant » !
« Composer est un formidable moyen de suspendre le temps. »
Comme le rappelle votre ami Michel Onfray, en citant Nietzsche dans la préface de votre livre « Cinquante questions pour 50 ans de questionnements » écrit en collaboration avec Nathalie Krafft, « Toute création est une autobiographie ». Étudier en profondeur les œuvres d’un compositeur, est-ce mettre à jour les multiples facettes de sa personnalité, son registre émotionnel, son chemin de vie ?
Une partition dit bien sûr beaucoup de son auteur, de son monde intérieur comme de sa poétique. Cela permet de connaître sa manière de penser les durées, la forme, la structure. Il demeure néanmoins quelque chose d’assez étonnant avec la musique, c’est qu’elle reste une langue finalement très secrète dans laquelle le compositeur fait passer des émotions que chacun traduira à sa façon dans une écoute qui, elle, sera au fond tout aussi secrète.
Lorsque justement vous faites passer dans votre composition des émotions secrètes et qui ne sont pas perçues de la même manière par l’interprète, comment lui indiquez-vous le chemin afin d’éviter tout contresens ?
Le travail avec les interprètes est quelque chose de tout à fait étonnant, fascinant même. Vous pouvez vous retrouver face à tout un tas de situations avec, par exemple, des interprètes qui vous feront découvrir quelque chose que vous n’avez pas perçu de votre propre musique, que ce soit un phrasé ou bien encore une émotion particulière. Certains seront proches de ce que vous voulez transmettre et d’autres, au contraire, ne s’avèreront pas en résonance avec ce message que vous souhaitez faire passer. Il y a en cela vraiment autant d’expériences que de collaborations. Avec le temps qui passe, il est évident que j’ai une affection toute particulière pour certaines et certains musiciens que j’aime retrouver car je sais nos mondes complémentaires. C’est cette idée de complémentarité qui me semble importante dans la création. J’aime cette notion de synergie entre le compositeur et l’interprète même si, évidemment, c’est le créateur qui amène le texte originel, fruit d’un travail de solitude, d’introspection et, à la fois, d’écoute du monde. Créer de la musique, c’est comme l’exprime si magnifiquement mon ami Michel Onfray, dire ce que l’on est dans sa propre autobiographie comme dans son rapport au monde mais également dire le monde tel qu’on le perçoit.
Votre livre se termine par cette phrase « Je n’ai plus peur de l’au-delà. » Thierry Escaich me confiait sa pensée selon laquelle « On ne composerait pas si on ne souhaitait pas laisser une part de soi-même après sa mort. » Laissez une trace derrière vous par le biais de vos œuvres, est-ce, là encore pour paraphraser Michel Onfray, un moyen de « mourir vivant » ?
J’aime beaucoup cette expression de Michel Onfray : « mourir vivant », avec cette idée d’être créatif jusqu’à son dernier souffle. La question de la mort, c’est vraiment la mauvaise nouvelle pour tous avec cette prise de conscience qu’un jour tout s’arrêtera. Même si les compositeurs souhaitent laisser une trace, on doit accepter cette fin, inéluctable pour tous. C’est avec cela qu’il faut lutter, avec cette idée que les choses vont s’arrêter. Je n’écris peut-être pas dans la conscience de laisser une trace, même si l’idée que l’on puisse jouer ma musique après ma mort me séduit, mais pour retarder la chose le plus possible. Composer est un formidable moyen de suspendre le temps. On a cette impression de se retrouver dans un autre temps et, à ce sujet, la sensation que j’ai lorsque je travaille est très curieuse. Devant une page blanche, je me concentre sur un autre temps, celui de la musique qui est en train de se fabriquer et cette projection de la musique qui se déroulera dans une temporalité réelle. La phase de composition me plonge dans le ressenti d’un temps qui devient suspendu. Une musique, c’est l’articulation du temps avec une poétique toute personnelle qui rend le travail tout à la fois concret et abstrait.

Pour revenir à votre déjà longue carrière de compositeur avec pas moins d’une centaine d’œuvres créées, pour quelles raisons le « petit Mozart » de la musique contemporaine que l’on avait fait de vous a-t-il été enterré vivant après son retour de Rome en 1994 ? Était-ce là le prix à « payer » pour obtenir une totale liberté de création ?
J’ai démarré très tôt et très fort, même si je ne suis pas satisfait de ces premières pièces qui m’ont values une certaine reconnaissance alors que j’étais encore très jeune ; Certainement trop jeune même puisqu’aujourd’hui ces pièces-là ne sont pour ainsi dire plus jouées. Néanmoins, le milieu de la musique contemporaine parisien s’est accroché à cette image musicale que j’ai donnée à l’époque, celle d’un compositeur d’avant-garde pour ne pas dire d’hyper avant-garde. Ce séjour que j’ai effectué à la Villa Médicis à Rome m’a amené à réfléchir très profondément sur ce que j’étais ou ce que je suis. J’ai donc souhaité écrire une musique qui soit plus en résonance avec mes racines tout en prenant en compte le temps présent. Je ne suis pas du tout passéiste, ni futuriste. Je ne sais pas ce que les compositeurs écriront dans une cinquantaine d’années et mon seul souhait est d’être en accord avec moi-même. Lors de ce séjour à Rome, j’ai ressenti une dissonance intérieure très forte car, même si mes œuvres m’avaient permis d’être nommé à 24 ans à la Villa Médicis, je ne ressentais pas ou plus d’émotion dans cette musique que j’avais composée. Ce long séjour à Rome a été l’occasion de me confronter à des œuvres d’art aussi bien architecturales que picturales, à des strates d’histoire qui ont résisté au temps. Je me suis dit que si je voulais moi aussi que mes œuvres résistent au temps qui passe, il fallait que j’opère un travail qui soit plus profond et non pas un travail dans l’ère du temps qui répondait à ce que l’on attendait de moi dans un milieu bien spécifique. Je suis donc un peu sorti du cadre en faisant l’école buissonnière et cela m’a valu ce que l’on sait. À mon retour de Rome, des personnes qui m’avaient soutenu m’ont tourné le dos mais ce n’était pas grave puisque d’autres m’ont ouvert les bras comme par exemple Rostropovitch.
Vous présentez vous-même votre langage modal comme le faisait Henri Dutilleux de « musique corrosive ». Peut-on dire qu’elle se veut un langage contemporain qui, sans regarder dans le passé, revendique une filiation de ses prédécesseurs ?
Je revendique bien sûr une filiation mais qui doit pouvoir éclore dans le temps présent. Je ne veux pas écrire « à la manière de » et déplacer un style à la Debussy ou Ravel à notre époque, cela n’aurait aucun sens. Il est sûr qu’un compositeur comme Sibelius m’a énormément fait réfléchir sur la manière de créer des arborescences qui sortent du développement sur lequel on a l’habitude de travailler pendant l’apprentissage. Il y a comme cela des concepts que l’on peut étudier des « anciens » et repenser sans être dans l’imitation du point de vue stylistique. Pour moi, l’erreur serait de déplacer un style d’une époque à une autre. On n’imagine pas aujourd’hui quelqu’un écrire dans le style de Palestrina, Mozart ou Brahms pour présenter le fruit de son travail dans des concerts de création. Cela serait tout simplement aberrant.
Vous évoquiez ces émotions ressenties, sources de création dont vous imprégnez vos œuvres. Avez-vous un processus spécifique de composition avec une période de réflexion où des sons, des phrases, des couleurs, des images naissent dans votre esprit avant de jaillir sur papier ?
Bien sûr. C’est vraiment à Rome que je me suis laissé la possibilité de ressentir et de traduire des émotions poétiques. Je me souviens de promenades nocturnes dans la ville avec cette lumière des monuments architecturaux qui ont généré des émotions encore fortement ancrées en moi plus de vingt-cinq ans après. Ces impressions très prégnantes peuvent également être d’un autre ordre. Cela peut être une lecture, un dialogue… Je suis très inspiré lorsque je mets en musique des poèmes de Michel Onfray par exemple. Je viens d’ailleurs de terminer une pièce pour soprano et orchestre à cordes il y a quelques jours, pièce que je relisais encore cet après-midi. La pièce que j’ai composée pour le 150 è anniversaire de la naissance de Sibelius est également un bon exemple de l’importance d’éléments extérieurs dans le processus créatif. J’ai eu la chance d’écrire cette pièce en Finlande. Cela a été pour moi l’occasion de ressentir une horizontalité du temps, un temps étale dans une campagne toute à la fois très douce et très puissante, extraordinairement inspirante pour l’écriture de cette œuvre. Mille choses peuvent être inspirantes ; la vie, l’amour, ma femme, mes enfants, mes amis… Tout est inspiration. Ce qu’il faut justement pour un créateur, c’est accepter ce tout et que ce tout se transforme en musique.

On vous sait grand amateur de peinture. L’élément purement visuel et pictural peut-il être le facteur déclencheur de la composition par le biais de l’émotion qu’il génère en vous ?
À la Villa Médicis, j’ai eu la chance d’être pensionnaire en même temps que Ming, le célèbre peintre chinois. J’allais très souvent le voir travailler dans son atelier et c’était un moment éblouissant et magique avec son rapport à la toile tellement physique. C’est vraiment un spectacle de voir Ming travailler ! Vous avez cette impression que les choses vont vite alors que tout est pensé dans le moindre détail. Cela s’avère réellement une expérience à part, très singulière. J’ai composé une pièce qui d’ailleurs s’appelle « Musique pour Ming » car passer des heures à le regarder travailler avait été pour moi un élément fortement inspirant. Avec Gérard Fromanger, immense artiste, nous avons donné un concert pendant lequel il a peint une fresque à laquelle j’ai participé alors que ma musique était jouée sur scène. J’adore cette idée de pouvoir ainsi côtoyer les peintres. On avait également joué un spectacle à Caen avec mon ami plasticien Philippe Borderieux. Lorsque j’étais adolescent, je n’imaginais pas que l’on devait être soit peintre, soit poète, soit compositeur… Cumuler tous les arts me semblait une chose possible. J’aimais particulièrement l’art pictural et j’ai d’ailleurs peint moi-même plusieurs toiles même si peu à peu la musique a pris toute la place pour, finalement, devenir mon seul moyen d’expression.
Au-delà du registre émotionnel, faut-il avoir en tant que compositeur une vision presque architecturale de l’œuvre pour structurer sa pensée au-delà de l’inspiration ?
Bien sûr et c’est d’ailleurs ce que j’explique toujours à mes élèves. Transmettre, c’est très important mais cela ne peut pas se limiter à des mots. Il faut transmettre un savoir-faire. Je tiens beaucoup à cette notion d’artisanat dans la composition. Vous parliez très justement d’architecture et, en effet, dans la composition, il y a des notions de construction et éventuellement de déconstruction. Penser la forme et un contenu qui soit en adéquation avec cette dernière est une chose primordiale afin que la poétique s’avère en synergie avec cette forme proposée. Il m’arrive d’ailleurs de donner à mes étudiants des exemples purement architecturaux afin de mieux comprendre la construction d’une composition musicale.
On se demande forcément comment un compositeur parvient à écrire des œuvres pour des instruments dont il ne joue pas ou encore comment il est possible d’entendre une symphonie complète dans son esprit avant même de coucher le texte sur papier. Pouvez-vous nous parler de ce processus tout à fait particulier qui nous laisse penser que, contrairement à la moyenne, un compositeur utilise bien plus que 10 à 20% de ses capacités cérébrales ?!
(rires) En fait, c’est un long apprentissage. J’étais violoniste et je conserve d’ailleurs pour le violon une passion et une admiration toute particulière. C’est vraiment là l’instrument qui m’habite. Bien sûr, en tant que compositeur, j’ai d’autres attirances fortes comme le violoncelle ou le piano par exemple. On apprend à écrire pour tous les instruments mais l’apprentissage s’opère surtout au contact des instrumentistes. Je ne connais pas un seul jeune compositeur qui n’ait pas commis une erreur technique. Cette erreur technique, même si un professeur vous la corrige, il faut la comprendre. Et pour la comprendre, il est indispensable de converser, d’échanger avec des interprètes. C’est là un parcours initiatique nécessaire. Je ne crois pas au compositeur qui, enfermé dans sa tour d’ivoire, ne dialogue pas avec les musiciens. Je conseille d’ailleurs à mes élèves de se constituer des équipes de musiciens afin de faire les choses ensemble. En tant que compositeur, vous écrivez la partition mais, surtout, vous écoutez les conseils des musiciens afin d’éviter de commettre des erreurs. Là est la clé. Bien sûr, après vient se greffer le talent soit pour l’orchestration, soit pour l’harmonie, soit pour tout d’ailleurs si l’on se réfère à certains grands compositeurs du passé, de Mozart à Brahms, Beethoven, Schumann, Vivaldi, Stravinsky qui eux avaient toutes les clés. Vous allez me dire que je ne parle pas de compositrices ! J’ai une admiration sans borne pour Kaija Saariaho et j’apprécie tout particulièrement le travail de Camille Pépin. Il ne faut jamais oublier qu’une page d’orchestre, c’est une journée entière de travail. Vous élaborez donc des strates et êtes capable d’entendre dans l’écriture la synergie entre ces différentes strates musicales.
En 1999, après « L’Éclipse », œuvre pour orchestre jouée en extérieur pendant l’éclipse donc, vous rencontrez Rostropovitch qui vous demande d’écrire un concerto pour violoncelle qui a été, entre-autres, dirigé par Ozawa. Pouvez-vous nous parler de cette rencontre et de cette création qui, je suppose, vous a marqué ?
Rostropovitch, c’est un monument absolu de la musique. Une fois que l’on a dit ça, reste à savoir ce qu’est un monument de la musique ! Et bien c’est d’abord une personne qui est puissamment et intensément musicien. Tout comme Ivry Gitlis que j’ai également eu la chance de beaucoup côtoyer, ce sont des musiciens capables de vous faire pleurer non pas avec six ou quatre notes, mais avec une seule. Ils jouent une note et le son est déjà si poétique, si beau, si émouvant que vous en avez les larmes aux yeux. Et ça, c’est quelque chose de très, très, très rare. En plus, j’adore cette idée chez un aussi grand que Rostropovitch, et j’invite d’ailleurs les jeunes interprètes à le faire, d’avoir été en phase avec les créations de son époque en demandant à des compositeurs contemporains de lui écrire des œuvres. Il a ainsi travaillé avec Chostakovitch, Dutilleux, Lutoslawski, Prokofiev, Britten… Bien sûr des musiciens jeunes ou moins jeunes jouent le jeu et sont très investis par la création, les mettant ainsi en regard du grand répertoire. Ils créaient ainsi un pont entre les pièces du passé et du présent. Je trouve d’ailleurs très beau de faire ce lien au sein d’un même concert et, ainsi, générer des résonances entre des œuvres écrites à plusieurs siècles d’intervalle.
Cette année de pandémie que nous avons traversée a plongé le monde de la musique et plus largement de la culture dans une situation pour le moins difficile. Cette étrange période a été pour vous source de création avec « Strange Times », cette œuvre symphonique pour grand orchestre, composée en grande partie pendant le premier confinement puis corrigée pendant le deuxième. Là où de nombreux musiciens ont eu bien du mal à réunir la motivation nécessaire pour continuer à travailler leur instrument, vous avez donc trouvé l’inspiration à la création même s’il s’agissait là d’une commande débutée avant le début de la pandémie ?
C’était effectivement une commande de Radio France et, à postériori, c’est presque un soulagement de constater que j’ai réussi à travailler dans un contexte qui était éminemment anxiogène pour le monde musical tout entier et ce moment très difficile que l’on traverse. Il se trouve que d’un point de vue concret, j’ai eu la chance d’avoir cette création qui m’a énormément motivé avec cette date du 4 février 2021 pour une première que je savais maintenue. Pendant le premier confinement, il fallait donc que je tienne les dates afin que mon éditeur ait le temps de fabriquer la pièce et que l’orchestre puisse recevoir la partition gravée. Avoir une échéance était quelque chose de fortement motivant. C’est là d’ailleurs le paramètre qui a posé problème à beaucoup de musiciens, ce manque de repère temporel. De nombreux concerts ont été annulés, non reportés et avec, a disparu la perspective de pouvoir partager la musique sur scène ou bien encore, parfois, en streaming, réduisant les espoirs à néant. Il ne faut pas oublier que la musique est quelque chose qui se partage, qui s’écoute, qui se vit ensemble. Privé de ce partage, certains ont perdu le moral, l’envie de travailler… Ce qui se passe est forcément angoissant. J’ai d’ailleurs été très impressionné par le fait que, dans cette situation, la plupart de mes étudiants ont tenu bon malgré les cours en vidéo. Avec tous les concerts d’étudiants annulés, je me suis dit que ces jeunes faisaient preuve d’une merveilleuse force de caractère dans ce moment où, justement, ils devaient expérimenter leurs propres créations avec des interprètes et se sont retrouvés, par la force des choses, dans l’impossibilité de mener à bien leur projet.
Cette composition, « Strange Times », diffère-t-elle justement de par sa création en plein doute pandémique de vos précédentes œuvres, moins guidée par la poésie, l’imaginaire, par une sorte de monde intérieur ?
Comme elle a été créée en Février, c’est-à-dire récemment, il y a tout d’abord eu la joie de l’entendre. Cela me renvoie à ce que me disait mon premier professeur de composition que j’adorais, Horatiu Radulescu, qui m’invitait à attendre dix ans avant de juger une pièce. Cette pièce étant tout fraîche, j’ai le sentiment d’avoir dit beaucoup par rapport à cette terrible période que l’on vient de passer, mais j’ai également le sentiment que cette pièce ne traduit pas uniquement l’angoisse d’un moment difficile mais se veut également porteuse d’un message d’espoir et explique certainement en partie pourquoi j’ai tenu bon. J’ai écrit avec en tête cette idée que cette pandémie allait bien finir un jour. Il ne faut bien évidemment pas non plus être d’une naïveté absolue et, même si des choses ont été possibles pour moi avec notamment des enregistrements discographiques, ma saison a quand même été très abîmée. Ce qui m’attriste, c’est que la saison prochaine s’annonce déjà comme presque pire dans le sens où beaucoup de pièces annulées ne sont tout simplement pas reprogrammées. Peut-être parce que des programmateurs pensent qu’ils vont faire revenir le public plus facilement avec des œuvres du grand répertoire plutôt qu’en intégrant des pièces contemporaines. Bien sûr, et il ne faut pas le négliger, certains jouent le jeu de la création. D’autres, par contre, tièdes pour ne pas dire frileux ne font pas cet effort et je trouve cela bien dommage.

Même si vous avez composé des concertos ou des pièces de musique de chambre, la composition pour un grand orchestre revêt visiblement dans votre processus créatif une dimension toute particulière et une véritable jubilation. L’absence de perspective de concert symphonique à moyen terme, vous le vivez comment ?
Cela veut dire que, pour moi comme pour beaucoup d’autres, la partie symphonique va être bien compliquée à faire vivre pendant quelques temps. Ce que j’espère avant tout, c’est que la création va continuer à faire intensément partie de la vie musicale au niveau symphonique. Mais le brouillard dans lequel nous sommes est tel que rien n’est pratiquement encore annoncé pour la saison à venir du point de vue des orchestres.
Tombé en admiration à l’écoute d’un disque d’Ivry Gitlis jouant les concertos de Tchaïkovski et de Mendelssohn, vous avez débuté la musique, comme vous le spécifiez tout à l’heure, par le violon et avez donc, à ce titre, connu cette sensation de vous retrouver au milieu de l’orchestre pour des concerts entouré du son. Cette joie du son produit, est-ce un élément clé prégnant lorsque vous composez ?
La joie de l’instrumentiste, c’est bien évidemment aimer jouer de la musique mais aussi aimer jouer de la musique entouré des autres. Cela fait trente ans que je n’ai pas pris place dans un orchestre symphonique, mais lorsque je repense à cette sensation unique, j’en suis presque ému aux larmes. Lorsque vous jouez la deuxième symphonie de Mahler, une symphonie de Beethoven ou Stravinsky d’ailleurs, c’est tellement puissant, cela s’avère d’une telle force au niveau du ressenti que ça vous marque à jamais. Aujourd’hui compositeur, je tente de perpétuer dans mes œuvres cette sensation restée ancrée en moi. J’ai tellement aimé jouer de la musique avec les autres que lorsque j’écris, je souhaite que celles et ceux qui écoutent mes créations puissent ressentir cette merveilleuse impression d’être ainsi plongé au cœur de l’orchestre et comprendre l’énergie folle qui s’en dégage.