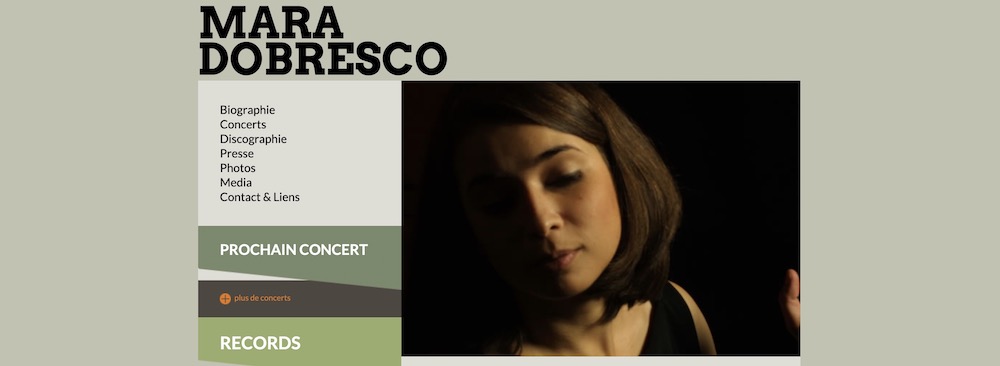Elle avait abordé l’univers musical de la nuit, c’est désormais au silence auquel la pianiste Mara Dobresco a décidé de s’atteler dans son nouveau projet discographique, « Le Fruit du Silence ». Si pour Gustav Mahler « la musique décore le silence », l’habit dont elle le pare dépasse sans nul doute largement ce simple cadre, les deux éléments se nourrissant l’un l’autre dans un incessant dialogue qui offre au texte toute la respiration nécessaire pour lui donner vie. De la sonate op.110 de Beethoven, composé alors que le maître est plongé dans le silence le plus absolu de sa surdité et démontre là une merveilleuse victoire de l’esprit sur la souffrance au répertoire contemporain de Oscar Strasnoy, Philippe Hersant ou encore Pëteris Vasks, Mara Dobresco brise avec une rare poésie la loi du silence.
« Les musiciens sont les maîtres du temps dont le silence se mue en une sorte d’outil invisible. »
« Le silence est l’étui de la vérité » écrivait René Char. Vous avez passé votre enfance en Roumanie sous l’ère de Ceausescu où la liberté de parole était mise à mal. La musique s’est-elle, dès le départ, imposée comme un merveilleux territoire d’expression où les notes remplaçaient les mots ?
En raison de la situation dure en Roumanie pendant le régime de Ceausescu, il est vrai qu’enfant que j’étais s’est drapé d’un relatif silence. J’avais bien intégré le fait que parler pouvait s’avérer dangereux et, même si cette pensée ne m’obsédait pas tous les jours, elle était néanmoins latente. Pour ce qui est du piano, j’ai reçu un enseignement très exigeant. Cela m’a certes beaucoup apporté sur le plan pianistique mais cette relative rudesse étant assez pesante, j’avais trouvé refuge dans un mutisme protecteur. Le point positif, c’est que j’ai très vite senti que je pouvais m’exprimer au travers de la musique, au-delà des mots. D’ailleurs, aujourd’hui encore, on me dit que je ne suis pas la même lorsque je me trouve devant mon piano. Le piano est certainement en cela ma vraie voix. Lorsque je suis arrivée en France pour suivre mes études au conservatoire national de Paris, j’ai immédiatement essayé de parler français ce qui m’a certainement permis de trouver un autre chemin, celui des mots. J’ai eu la chance, au conservatoire, de travailler avec de merveilleux musiciens que j’admirais tels que Gérard Frémy, Cristian Ivaldi, Pierre-Laurent Aimard… qui m’ont aidée à ouvrir tous mes horizons dont celui de la parole. Plus tard, en dehors du conservatoire, mes rencontres avec Martha Argerich, Dominique Merlet ou Jean-Claude Pennetier ont également énormément compté et ont marqué ma vie d’interprète.

Vous mentionniez le merveilleux pianiste et pédagogue Jean-Claude Pennetier que j’ai eu la chance d’interviewer et qui a été pour vous une grande source d’inspiration musicale et spirituelle. Jean-Claude Pennetier me disait : « J’envisage la musique et la foi comme des possibilités d’entrer à l’intérieur de ce qui est. La musique, c’est cette merveilleuse possibilité de se relier, au-delà de nous-même, en notre centre le plus profond. » Je suppose que c’est là une approche que vous partagez totalement ?!
C’est effectivement une vérité que j’essaye d’expérimenter. Jean-Claude Pennetier est pour moi, tout autant que le regretté Dinu Lipatti, une merveilleuse source d’inspiration tout à la fois pour le musicien mais également pour l’homme qu’il représente. Les mots de Dinu Lipatti me reviennent d’ailleurs à l’esprit pour exprimer ce que nous cherchons en nous. Il disait : « Cherchez la lumière au plus haut chez les autres et au plus profond de vous-même. » C’est ce plus profond de nous-même en lequel nous allons puiser dans l’interprétation ; cette sorte de sphère lumineuse du chef-d’œuvre de la composition que nous devons filtrer par notre être pour la rendre vivante. J’ai eu cette chance de travailler aux côtés de Jean-Claude Pennetier à l’académie Ravel dans le cadre d’une master-classe juste avant l’enregistrement de mon premier disque consacré à Schumann. De là est née une amitié qui n’a fait que croître avec le temps. Je dis souvent de lui que j’ai reçu deux fois sa bénédiction ; une fois du musicien lors de notre concert à quatre mains à la philharmonie de Bucarest et la seconde lorsque le prêtre orthodoxe qu’il est a béni mon mariage avec le pianiste et chef d’orchestre Nicolas Kruger. Avec Jean-Claude, au-delà de la musique, notre amour commun pour le théâtre est souvent le fruit de longs et beaux échanges. J’ai toujours été attirée par les mots et le côté scénique d’un concert même si ce n’est que dernièrement que j’ai pu rendre visible cette autre passion. J’ai ainsi participé à plusieurs projets dont un mis en scène par Jean-Claude Pennetier lui-même dans les « Liebeslieder Walzer » de Brahms. Plus tard, cet amour des mots a chez moi pris forme dans la traduction du poète roumain Marin Sorescu qui j’ai mis en scène en compagnie du merveilleux comédien Denis Lavant.

La vie, c’est un peu cette perpétuelle recherche d’un temps perdu proustien, un temps qui, inexorablement, passe et que l’on retrouve d’ailleurs dans certains poèmes de Marin Sorescu, lus par Denis Lavant, et que vous avez donc mis en musique. Ce rapport au temps et au passage éclair de l’existence, cela vous inspire quoi justement ?
Le temps qui passe est le point central de ce spectacle qui s’intitule « Il faut donc que vous fassiez un rêve. » Les textes que j’ai choisis, qu’ils soient extraits du « Journal en miettes » de Eugène Ionesco ou des poèmes de Marin Sorescu, parlent justement de ce passage du temps. Il y a tout d’abord l’univers de l’enfance, ce paradis perdu qui est un thème tout à fait passionnant à mes yeux. Alors, forcément, lorsque je trouve un grand enfant comme peut l’être Denis Lavant, c’est un régal de partager avec lui mes impressions. Denis m’a énormément appris, car au-delà du comédien et de l’artiste formidable se cache également un être humain extraordinaire dans le sens le plus littéral du terme, un adulte avec une merveilleuse âme d’enfant et ce regard toujours curieux et sincère sur tout ce qui l’entoure. Ionesco dit que « l’enfance, c’est le monde du miracle ou du merveilleux. » et poursuit en expliquant « qu’il n’y a plus d’enfance à partir du moment où les choses ne sont plus étonnantes. » C’est ce rapport à la vie, aux choses comme aux êtres qui nous entoure et ce regard étonné qui m’intéresse, m’anime et fait peut-être se distendre le temps.

Votre prochain disque à venir, « Le Fruit du Silence », est, dans sa première partie, un hommage à Beethoven qui, à la fin de sa vie, a dû, en raison de sa surdité, composer dans le silence comme les dernières de ses 32 sonates tel l’opus 110. Cette surdité et cette composition qui nait dans le silence, on la retrouve également chez Fauré dans « L’horizon chimérique » ou encore son Quatuor à cordes achevé quelques mois avant sa mort alors qu’il était sourd. Ces œuvres revêtent forcément un caractère tout à fait particulier. Sont-elles à vos yeux la quintessence d’une souffrance tout autant que cette possibilité de plonger au plus profond du Moi du compositeur seul face à son « handicap » ?
Oui, je le pense. Beethoven, on le sait, a beaucoup souffert de cette solitude imposée par sa surdité. On sent dans ses dernières sonates que j’ai choisi d’interpréter, l’op.109 et l’op.110, une forme de détachement. Le troisième mouvement de l’op.110 a quelque chose de tout à fait bouleversant et résonne de manière toute particulière dans mon esprit, surtout avec cette période de pandémie et de relatif silence forcé de la musique que nous vivons. On sait que Beethoven a écrit cette sonate après une très longue période de convalescence qu’il a d’ailleurs définie comme « la lutte de l’homme contre la souffrance ». La fin de cet op.110 marque la magnifique victoire de l’esprit. J’ai souhaité partager avec le public ce message tellement fort. Grâce à René Martin, j’ai d’ailleurs pu interpréter cette pièce l’année dernière au Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron, rare concert que j’ai pu donner lors de cette pandémie. Un moment inoubliable ! C’est je crois à ce moment-là qu’est né le début de ma réflexion sur le programme de ce disque consacré au silence, cet op.110 ayant procuré une rare émotion au public que j’ai pu constater entre ces deux silences qui précèdent et viennent clore le concert.
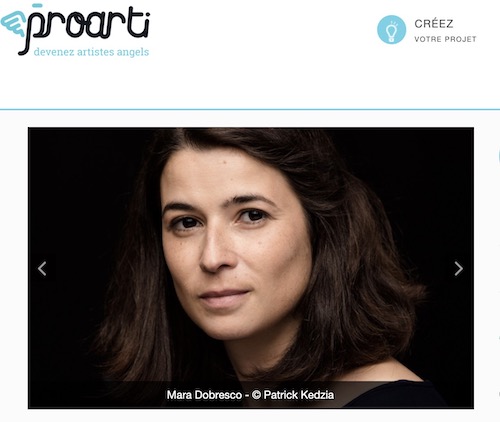
Dans ce disque, vous mettez également à l’honneur des compositeurs contemporains tel Peteris Vasks qui s’est inspiré d’un texte de Mère Teresa. Comment s’est opéré le choix de ces œuvres ?
Grâce aux rencontres faites pendant mes études au CNSM avec Pierre-Laurent Aimard, György Kurtag ou Oscar Strasnoy, j’ai commencé à m’intéresser à la musique de notre temps. J’ai donc collaboré en tant que soliste, en compagnie du quatuor Face à Face ou encore de l’ensemble K dont je fais partie, avec plusieurs compositeurs tels Philippe Hersant, Philippe Leroux, Franck Villard et bien d’autres. Il est merveilleux de pouvoir communiquer directement avec le compositeur et constater à quel point ces derniers sont ouverts quant à l’interprétation de leur œuvre. Une création est toujours une merveilleuse aventure musicale et humaine. La musique d’Oscar Strasnoy comme celle de Philippe Hersant m’accompagnent depuis très longtemps et font partie de mon cheminement d’interprète. L’œuvre de Peteris Vasks, « Le Fruit du Silence », qui vient clore ce programme est une magnifique anaphore de mère Teresa qui dit : « Le fruit du silence est la prière. Le fruit de la prière est la foi. Le fruit de la foi est l’amour. Le fruit de l’amour est le service et le fruit du service, la paix. » C’est la conclusion de ma recherche dans ces silences qui nous habitent, nous entourent et nous guident dans une forme de spiritualité. Je pense qu’il est de la mission des interprètes d’apporter cette musique d’aujourd’hui sur scène. Évidemment, les organisateurs de concerts doivent nous accompagner dans ce travail et ce n’est hélas pas toujours le cas. Le public, lui, est par contre très réceptif à ces musiques contemporaines lorsque l’interprète est heureux et convaincu par ce qu’il joue. Pour ce nouveau disque, c’est un réel plaisir d’avoir pu poursuivre ma collaboration avec Oscar Strasnoy et Philippe Hersant, collaboration qui a généré chez eux la création de deux nouvelles œuvres sur lesquelles je pose un premier regard.

Si le silence peut faire peur, il est aussi méditatif, contemplatif… À titre personnel, quel rapport entretenez-vous avec ce ou plutôt ces silences ?
J’aime le silence, la solitude même. J’ai d’ailleurs besoin de cette solitude pour me plonger dans mes projets ; faire silence autour de moi pour mieux entendre les pensées qui chuchotent. Pour les enregistrements, il me faut entrer dans une phase d’isolement nécessaire pour me retrouver totalement, me plongeant au plus profond de moi-même pour ainsi me débarrasser des désirs comme des soucis quotidiens. Ce cheminement est indispensable pour tenter de parvenir à cette vérité absolue vers laquelle on tend lorsque l’on enregistre un disque.
On le sait, au sein même d’une œuvre, le silence est primordial puisqu’il permet de faire respirer, de passer d’un son à un autre. Lorsque vous abordez un texte, le silence revêt-il une importance aussi grande que les notes en elles-mêmes pour donner à l’œuvre toute sa dimension émotionnelle ?
Absolument. Les silences ont un rôle révélateur. Ils sont le poumon de la musique. C’est d’ailleurs très beau qu’en français on puisse désigner un silence dans un texte par le terme soupir. Ce moment peut donc être un silence, un soupir, une respiration, un pont d’une note à l’autre, une suspension, une attente… Je pense d’ailleurs que pendant un silence en musique il peut y avoir une formidable accumulation d’énergie ou une perte d’énergie qui nous bouleverse comme dans cet op.110 de Beethoven. On y sent tous ces soupirs qui s’accumulent et qui empêchent le discours d’avancer. C’est là qu’intervient tout l’art de l’interprète qui doit savoir doser cette énergie. Les musiciens sont les maîtres du temps dont le silence se mue en une sorte d’outil invisible.
Avant « Le Fruit du Silence », vous parcouriez, de Schumann à Grieg, Britten à Lipatti, Chopin à Hersant, Enesco ou Debussy vos « Soleils de Nuit ». La nuit, comme le silence, est un parfait monde propice à la médiation, à une plongée intérieure. Peut-on dire que nous sommes là clairement dans ces deux projets dans une continuité musicale et intellectuelle ?
Oui, même si je n’ai pas cherché cette continuité qui s’est imposée à moi. Je suis dans une période de ma vie où je ne ressens plus le besoin de plaire à tous prix ou de devoir prouver quelque chose. Accepter cet état est une réelle libération et les choix de mes programmes sont vraiment à l’image de qui je suis aujourd’hui.
Le silence et la nuit, c’est aller au fond de soi pour, justement, s’attacher au fond. Ne pensez-vous pas hélas qu’aujourd’hui la forme a pris le pas sur le fond dans un monde régi par l’image et une certaine instantanéité pour ne pas dire superficialité des choses ?
Hélas oui, je partage cet avis et comme le disait Saint-Exupéry : « L’essentiel est invisible pour les yeux. » Dans un monde comme vous le disiez régi par l’image, on doit réfléchir à tout cela. Au-delà d’une époque dédiée au visuel, pire encore, nous sommes dans une époque sans fond. Vous pouvez ainsi rester des jours entiers sur les réseaux sociaux, il n’y a pas de fin. Même chose pour les chaînes de télévision pour enfants avec des dessins animés qui tournent en boucle. Dans notre société, la seule fin possible est celle que l’on s’impose soi-même. Pour les jeunes, cela passe forcément par l’apprentissage d’une certaine frustration. Cette situation n’est peut-être en définitive que le miroir de cette notion d’éternel qu’a toujours cherché l’humain. Aujourd’hui, on veut nous faire croire que la santé est la valeur la plus importante et que la mort est mise entre parenthèses. Certes la santé est essentielle mais il existe d’autres valeurs comme l’amour, la générosité ou le partage que l’on a trop tendance à oublier. Être en bonne santé ne suffit pas à remplir une existence. Avec ces confinements successifs, on a senti la vitesse infernale dans laquelle vit notre monde pour une fois mis à l’arrêt forcé. Aujourd’hui, on veut tout et tout de suite dans une forme prémâchée de l’information. Je vais à nouveau citer mon cher Ionesco qui disait : « La vitesse n’est pas seulement infernale, elle est l’enfer même. Elle est l’accélération dans la chute, la progression géométrique de la chute nous a lancé dans du rien. » Malgré mes lectures de Ionesco et Cioran, j’ai quand même, je vous rassure, foi en cette victoire de l’esprit dont parlait Beethoven.

Cette année pour le moins étrange, anxiogène et dramatique pour la culture que nous venons de vivre a eu, comme nous l’évoquions, au moins un bénéfice, lors du premier confinement de mars 2020 surtout, celui d’une société en effervescence qui prend du recul sur elle-même et donne à nouveau du temps au temps. Comment a titre personnel, au-delà, de vos projets créatifs, avez-vous vécu cette période ?
Difficilement, je pense comme tous les artistes, tous les musiciens. J’ai d’abord eu l’impression de retrouver, pendant le premier confinement, ce temps de mon enfance. Je ne regardais plus ma montre, je ne savais plus quel jour nous étions et je me sentais très bien comme cela. La course dans laquelle nos vies nous avaient embarqués s’était arrêtée un instant. C’est dans cette longueur, ce temps suspendu que je me suis interrogée sur le pourquoi des choses, tentant d’apporter une réponse à mes questionnements. Je me suis dit qu’il était peut-être intéressant de se poser, de prendre le recul nécessaire pour regarder derrière comme devant soi. Cela m’a également permis de comprendre à quel point le partage avec le public est l’élément essentiel de notre métier. On a pendant cette période de pandémie toutes et tous été amenés à réaliser des captations vidéo dans des salles vides puisque c’était là une espèce de survie, la seule chose possible. Là, on s’est rendu compte à quel point le public nous manquait. Lors du concert, il y a un échange spontané entre l’interprète et le public où chacun des deux donne quelque chose à l’autre. L’énergie qui émane des auditeurs influe forcément sur l’acte interprétatif lui-même.

Je crois d’ailleurs que, lors de vos concerts, vous aimez interagir avec le public venu vous écouter, brisant en cela quelque peu les codes rigides du récital. Pensez-vous justement qu’il est important de prendre le public par la main, de l’aider à entrer dans des œuvres qui sortent des sentiers battus permettant en cela de quelque peu démocratiser une musique classique que beaucoup considèrent encore figée et « pas pour eux » ?
Comme je vous le disais en début d’interview, j’ai toujours aimé ce côté scénique du récital. Je pense qu’à partir du moment où l’artiste entre en scène, il prend en charge le public. Plusieurs fois, en m’adressant directement aux personnes venues m’écouter, j’ai pu constater qu’elles s’installaient plus confortablement dans le concert. Cela permet de briser la glace et de les faire entrer avec moi dans un autre univers, un peu comme cela se produit au théâtre avant que le rideau se lève. J’aime ainsi prendre les auditeurs par la main et les mettre dans la lumière car je pense que cela rend l’écoute différente. Parfois, pour certaines œuvres, je leur propose même de fermer les yeux et d’oublier qu’ils se trouvent dans une salle de concert, de se laisser guider par cette écoute pour simplement profiter du moment.